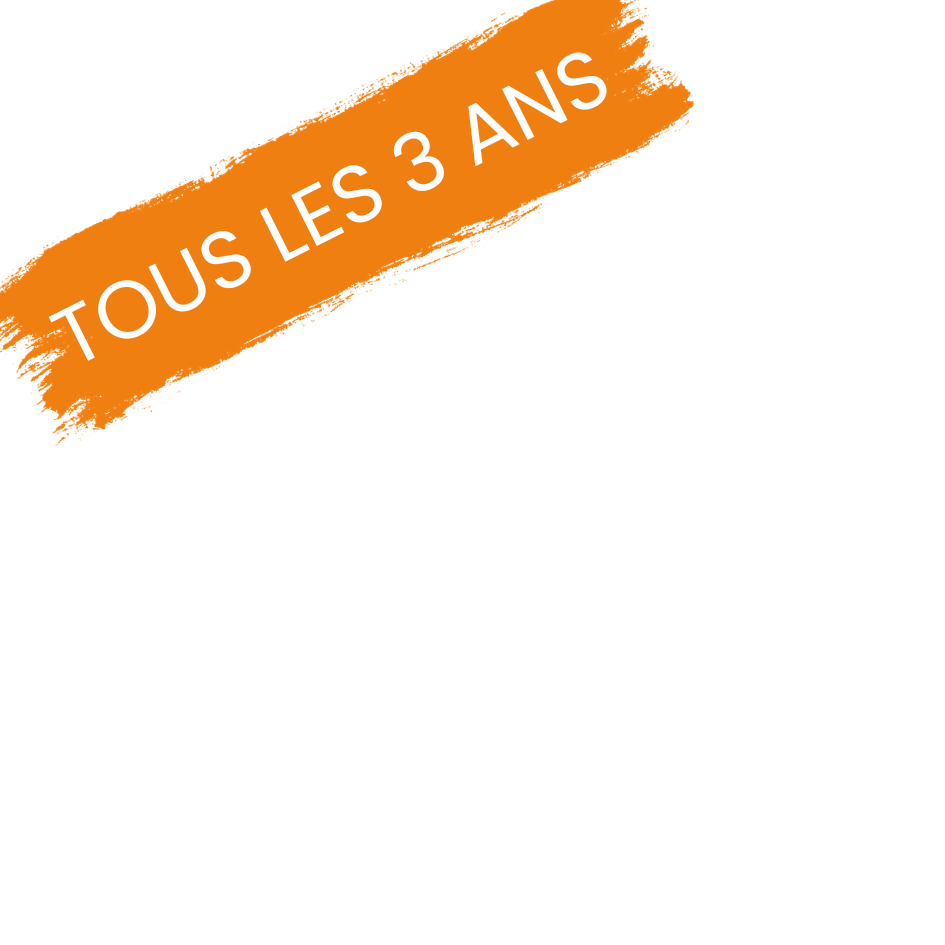Formation ajoutée à la réservation
Laura, 35 ans, en couple, arrive en séance les larmes aux yeux. Deux jeunes enfants (un garçon de 4 ans et une fille d’1 an et demi),  des nuits hachées, un quotidien épuisant. Et une question lancinante : « Pourquoi je n’y arrive pas ? »
des nuits hachées, un quotidien épuisant. Et une question lancinante : « Pourquoi je n’y arrive pas ? »
Derrière cette question, un désarroi profond et une impression de perdre pied. Laura se plaint de pleurer « tout le temps », ressent une agressivité qui la surprend elle-même, crie sur ses enfants et son compagnon puis s’en veut aussitôt… Laura est piégée dans une boucle : épuisement → irritabilité (cris, pleurs) → culpabilité → tentatives de régulation → épuisement.
Le cadre comme ressource, pas comme carcan
L’une des premières pistes explorées par la thérapeute est celle du cadre éducatif, qui précise la vision de monde de Laura. Elle dit ne pas vouloir être trop dure. Mais ses « non » sont flous, ses limites mouvantes. Et sa fille, comme tout petit être logique, cherche à comprendre ce qui fonctionne. Or ce qui fonctionne, ce sont ses cris. Pas les règles. Quand la forme du message des parents (cris, exaspération) prend le dessus sur le fond (la règle), le message devient flou. Quand Laura s’excuse d’avoir crié, sa fille ne distingue pas la forme du fond : c’est comme si sa maman annulait le rappel au cadre. Et la petite fille, renforcée dans une toute-puissance temporaire, devient de plus en plus exigeante… et de moins en moins supportable.
Le recadrage est simple mais stratégique : la clarté des règles est un acte de soin. Dire non, poser une conséquence, et tenir, c’est sécurisant. Et si la forme dérape (un cri, une colère), rien n’empêche d’y revenir mais plus tard, calmement, pour ajuster la forme sans renier le fond.
Quand les nuits ne sont plus réparatrices
Laura ne dort pas, son compagnon non plus. Et son couple est en tension constante. Une hypothèse est posée par la thérapeute : et si le problème n’était pas tant le sommeil des enfants que l’incapacité des parents à récupérer ?
Des tâches sont alors proposées à Laura :
-
Crier 15 minutes par jour… mais volontairement. Pour que la colère ait un lieu, un temps, un exutoire. Il s’agit ici d’une tâche à 180° pour contrer la tentative de régulation « j’essaie de garder mon calme mais finis par exploser ». De permettre à Laura d’exprimer sa colère de façon plus contrôlée, avant d’arriver au trop plein. Ceci implique que les signaux précurseurs de la colère de Laura aient été préalablement identifiés avec elle.
-
Alterner des nuits complètes de vrai repos : l’un des deux parents pourrait dormir ailleurs trois jours par semaine. Pas par sanction pour l’enfant ni pour générer le changement, mais pour régénérer le système, pour permettre aux parents de reprendre de l’énergie afin de mieux tenir bon. Ce type de prescription peut d’ailleurs avoir un impact stratégique : en expliquant à l’enfant que les parents ont besoin de dormir, et donc que s’ils sont réveillés l’un des deux devra découcher, cela peut parfois motiver l’enfant à davantage essayer de se rendormir seul. Et si Laura n’a pas la possibilité d’aller dormir ailleurs, on peut lui proposer d’alterner les nuits avec son compagnon.
-
Prescrire le symptôme : et si vous alliez jusqu’au bout de votre tentative ? Si les parents se disent qu’ils ne sauront de toutes façons pas ne pas céder, alors mieux vaut qu’ils prévoient clairement de dormir avec l’enfant. Cela n’aidera pas l’enfant à dormir seul, mais permettra aux parents de ne plus être dans la lutte qu’ils perdent et où les crises s’accumulent. Après avoir conscientisé les parents sur le fait que cela leur permettra de récupérer mais pas d’apprendre à leur enfant à dormir seul, le thérapeute peut ainsi proposer d’installer un matelas dans la chambre pour être plus confortables. Dormir ensemble, mais de façon choisie.
Petits tickets, grandes victoires
L’enfant, généralement à partir de 4 ans, peut aussi être mobilisé dans une dynamique responsabilisante, par exemple en lui offrant des tickets sommeil chaque nuit (nombre à définir par le patient). Quand ils sont utilisés, pour une demande de câlin ou autre, le parent accueille l’enfant. Mais si l’enfant revient une fois les tickets épuisés, le parent lui rappelle le cadre et ne répond plus à sa demande. L’idée est d’apporter un message d’équilibre à l’enfant : mon besoin de sécurité ne peut pas être satisfait en détruisant le sommeil de tout le monde.
Dormir ensemble ou seuls ? Ce que dit (vraiment) la recherche
Ici, le modèle de Palo Alto rappelle une vérité précieuse : pas de solution unique, seulement des solutions écologiques. Dormir ensemble n’est pas une aberration. Dans beaucoup de cultures, c’est la norme. Et aucune étude à notre connaissance ne permet de dire que « dormir seul tôt » constituerait un avantage développemental. Ce qui importe, c’est de faire un choix assumé, cohérent, qui renforce le message éducatif souhaité et respecte les besoins de base de toutes les parties en présence.
Ce que Laura a appris
Laura a compris que tenir une règle ne veut pas dire être dure, que récupérer du sommeil est un droit parental non négociable, et que sa colère est un signal, pas une faute morale. Que ressentir de la colère et l’exprimer est sain, chez le parents comme chez les enfants, que c’est la violence qui pose problème. Laura a aussi appris à recadrer ses attentes, à choisir ses batailles, et à honorer ses objectifs : retrouver de l’énergie, préserver son couple, et aider ses enfants à grandir dans un cadre aimant et respectueux de tous.
Caroline de Dieudonné, Marina Blanchart et Gil Vertongen